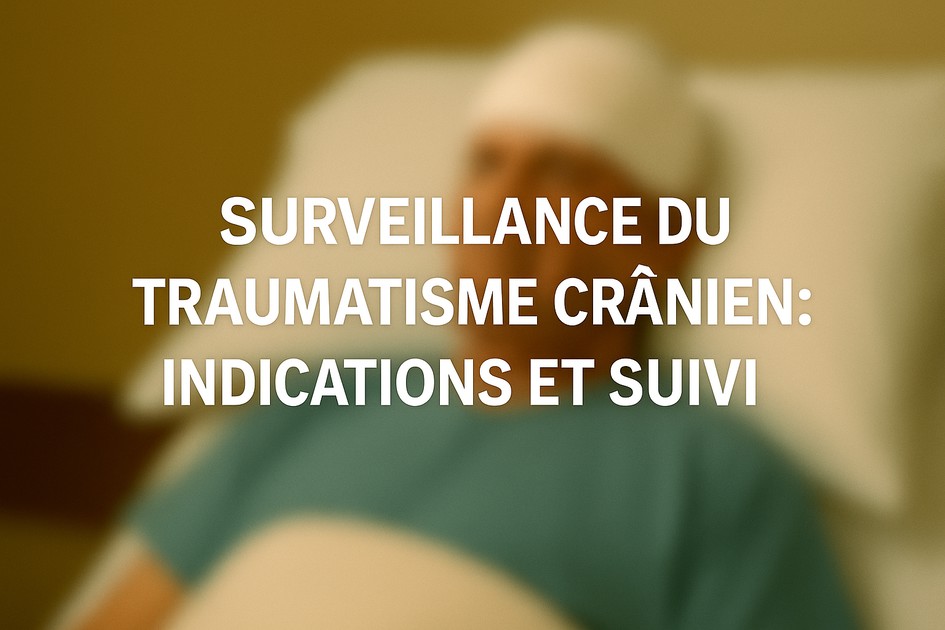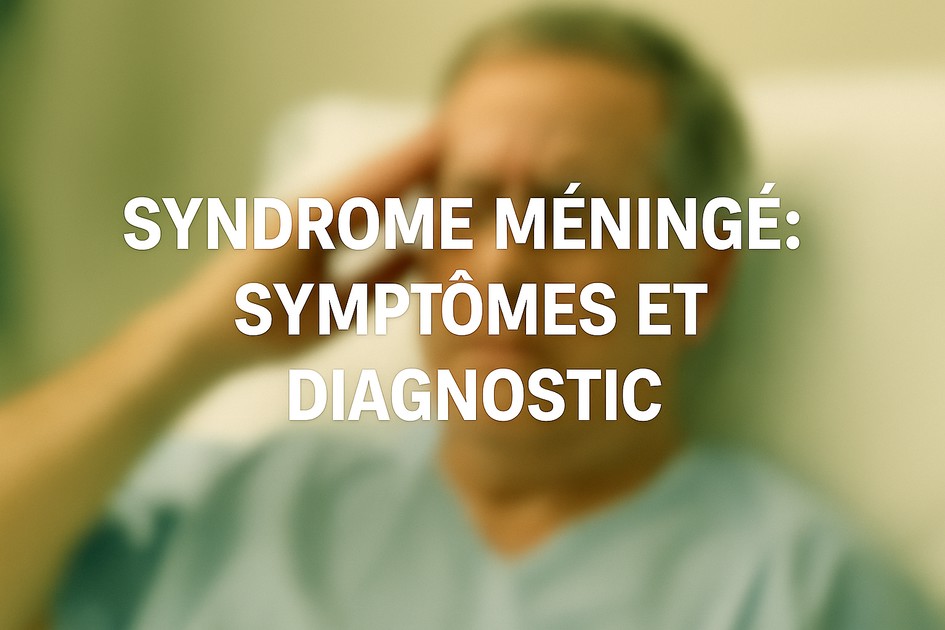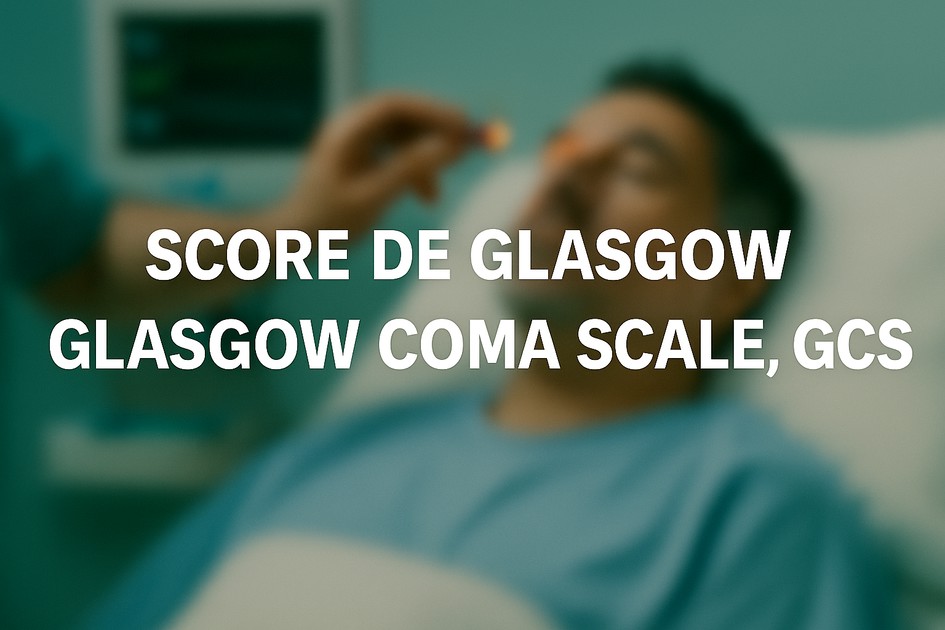Introduction
Le traumatisme crânien (TC) est une pathologie fréquente, touchant chaque année des centaines de milliers de personnes en Europe, avec des conséquences potentiellement graves, même après un choc qualifié de « léger ». La surveillance attentive des patients ayant subi un TC est essentielle pour dépister précocement les complications, adapter la prise en charge et prévenir les séquelles neurologiques. Les indications de surveillance et les modalités de suivi varient selon la gravité du traumatisme, l’âge du patient et la présence de facteurs de risque.
Symptômes et complications
Les symptômes d’un traumatisme crânien varient en fonction de la sévérité de l’atteinte :
- TC léger : céphalées, nausées, vomissements, troubles de la concentration, somnolence, irritabilité, amnésie ou perte de connaissance brève.
- TC modéré à sévère : troubles de la conscience prolongés, déficit neurologique focal, convulsions, agitation, signes de fracture du crâne (hémotympan, rhinorrhée ou otorrhée de liquide clair, ecchymose péri-orbitaire ou mastoïdienne), vomissements répétés, troubles visuels ou auditifs.
Les complications immédiates ou secondaires peuvent inclure :
- Hématome intracrânien (épidural, sous-dural), œdème cérébral, contusions cérébrales.
- Syndrome de la deuxième commotion : aggravation rapide en cas de nouveau choc.
- Séquelles à long terme : troubles cognitifs, céphalées persistantes, troubles de l’humeur, épilepsie post-traumatique.
La triade de Cushing (bradycardie, hypertension, bradypnée) est un signe de gravité extrême, traduisant une hypertension intracrânienne menaçante.
Le traumatisme crânien chez l’enfant
Le traumatisme crânien (TC) est particulièrement fréquent chez l’enfant, représentant une cause majeure de consultation aux urgences pédiatriques. Plusieurs spécificités anatomiques et physiologiques rendent les enfants plus vulnérables : un rapport tête-corps plus élevé, une boîte crânienne plus fine et une immaturité cérébrale et squelettique exposent à des lésions différentes de celles de l’adulte. Les nourrissons et jeunes enfants présentent notamment un risque accru d’œdème cérébral diffus et de lésions axonales diffuses, tandis que les hématomes intracrâniens sont relativement moins fréquents que chez l’adulte.
La clinique est souvent atypique : les nourrissons peuvent manifester une irritabilité, une léthargie, une perte du contact visuel, un regard en coucher de soleil, un bombement de la fontanelle antérieure ou des bradycardies, signes évocateurs de souffrance cérébrale ou d’hypertension intracrânienne. Les vomissements, les troubles de la conscience, les convulsions ou des troubles moteurs peuvent également survenir. Il est important de rechercher des signes indirects de gravité, comme une somnolence persistante, des troubles de la coordination, ou des modifications du comportement.
Les traumatismes crâniens chez l’enfant sont le plus souvent bénins, mais ils constituent la première cause de mortalité et de handicap sévère chez le grand enfant et l’adolescent. Par ailleurs, certains contextes imposent une vigilance particulière : les traumatismes non accidentels (syndrome du bébé secoué) doivent être systématiquement recherchés chez le nourrisson, et leur suspicion impose un signalement légal.
Le suivi doit être adapté : surveillance clinique rapprochée, évaluation du score de Glasgow, recherche de signes d’aggravation, et adaptation du retour aux activités scolaires et physiques en fonction de l’évolution des symptômes. La plupart des symptômes régressent en 1 à 3 semaines, mais une surveillance prolongée est parfois nécessaire pour dépister les séquelles neurocognitives ou motrices.
Surveillance
La surveillance dépend du niveau de gravité du TC :
- TC léger (Glasgow 13 à 15) : la majorité des patients peuvent être surveillés à domicile, sous réserve de l’absence de facteurs de risque et de bonne évolution clinique. Les critères justifiant un scanner cérébral en urgence incluent : GCS < 15 deux heures après le TC, suspicion de fracture ouverte, signes de fracture de la base du crâne, vomissements répétés, âge > 65 ans, céphalées sévères, convulsions, intoxication, ou amnésie persistante.
- TC modéré : hospitalisation pour surveillance neurologique rapprochée, imagerie cérébrale systématique, réévaluation clinique régulière, TDM de contrôle si aggravation clinique.
- TC sévère : admission en réanimation, monitorage de la pression intracrânienne, prise en charge neurochirurgicale si nécessaire.
Modalités de surveillance
- Surveillance clinique : évaluation régulière du score de Glasgow, des pupilles, des signes vitaux (pouls, tension artérielle, fréquence respiratoire), recherche de nouveaux signes neurologiques, aggravation des céphalées ou apparition de vomissements.
- Fréquence : toutes les 30 minutes jusqu’à normalisation du Glasgow, puis toutes les 1 à 2 heures pendant au moins 12 à 48 heures selon la gravité et l’évolution.
- À domicile : repos strict, éviter les activités à risque, surveillance par un proche, consignes claires pour consulter en urgence en cas de somnolence excessive, vomissements répétés, troubles du comportement, convulsions ou déficit neurologique.
Prévention des complications
- Éviter les suraccidents : limiter les déplacements, éviter les efforts physiques, adapter l’environnement.
- Informer l’entourage : reconnaître les signes d’alerte et réagir rapidement.
- Suivi médical : consultation de contrôle après 48 heures ou plus tôt si apparition de nouveaux symptômes.
Conclusion
La surveillance du traumatisme crânien est un enjeu majeur pour prévenir les complications immédiates et à long terme. Elle repose sur l’identification rigoureuse des facteurs de risque, une évaluation clinique régulière et l’adaptation du suivi en fonction de la gravité du traumatisme. Un accompagnement attentif, à l’hôpital ou à domicile, permet de sécuriser la prise en charge et d’optimiser le pronostic neurologique des patients victimes de traumatisme crânien.
Références :
- https://campus.neurochirurgie.fr/article1520.html
- https://pap-pediatrie.fr/urgences/traumatisme-cranien-leger-de-lenfant
- https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/02_congres/Urgences/urgences2013/donnees/pdf/103_Fiorentino.pdf
- https://ch-bassindethau.fr/wp-content/uploads/2017/11/Surveillance-dun-traumatisme-cranien-benin-a%CC%80-domicile.pdf
- https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/rug/protocoles/traumatologique/19_12_20_rug_tcc.pdf
- https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/l%C3%A9sions-et-intoxications/traumatismes-cr%C3%A2niens/pr%C3%A9sentation-des-traumatismes-cr%C3%A2niens
- https://campus.neurochirurgie.fr/article1787.html
- https://www.chu-nantes.fr/traumatisme-cranien-chez-lenfant
- https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/l%C3%A9sions-et-intoxications/traumatismes-cr%C3%A2niens/pr%C3%A9sentation-des-traumatismes-cr%C3%A2niens
- https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/02_congres/Urgences/urgences2007/donnees/pdf/05_emeriaud.pdf
- https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2004/07/35-40.pdf
- https://revue-mir.srlf.org/index.php/mir/article/download/818/780/1106
- https://pap-pediatrie.fr/urgences/traumatisme-cranien-leger-de-lenfant