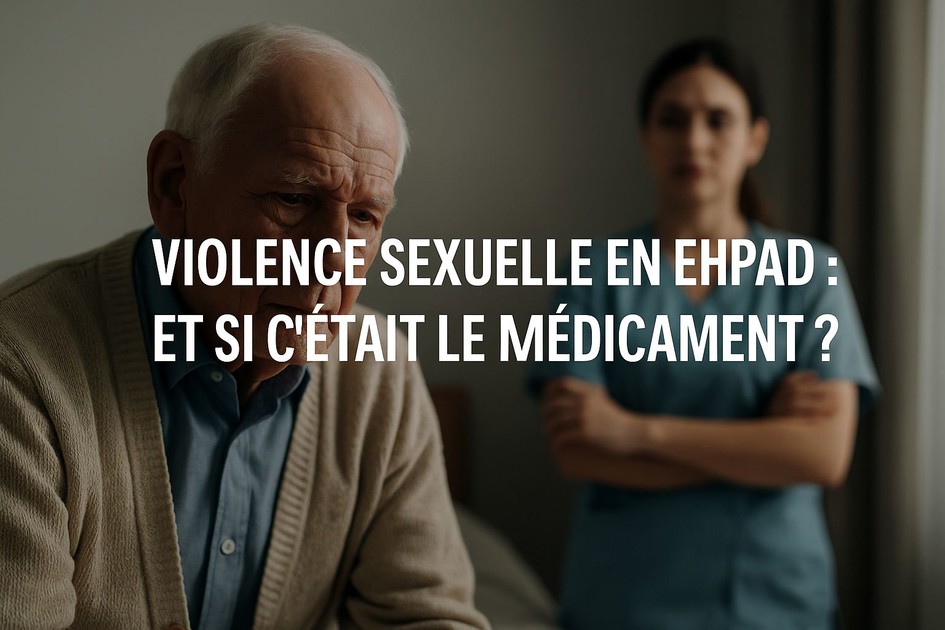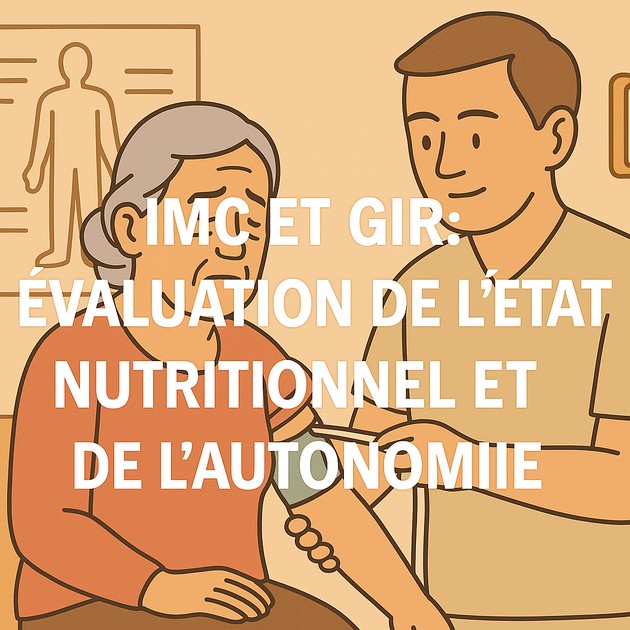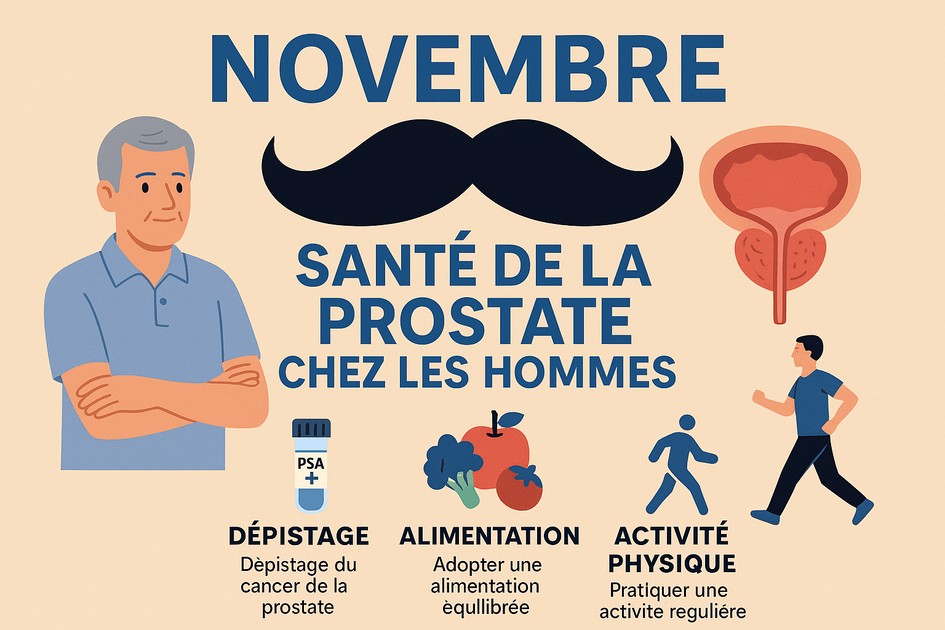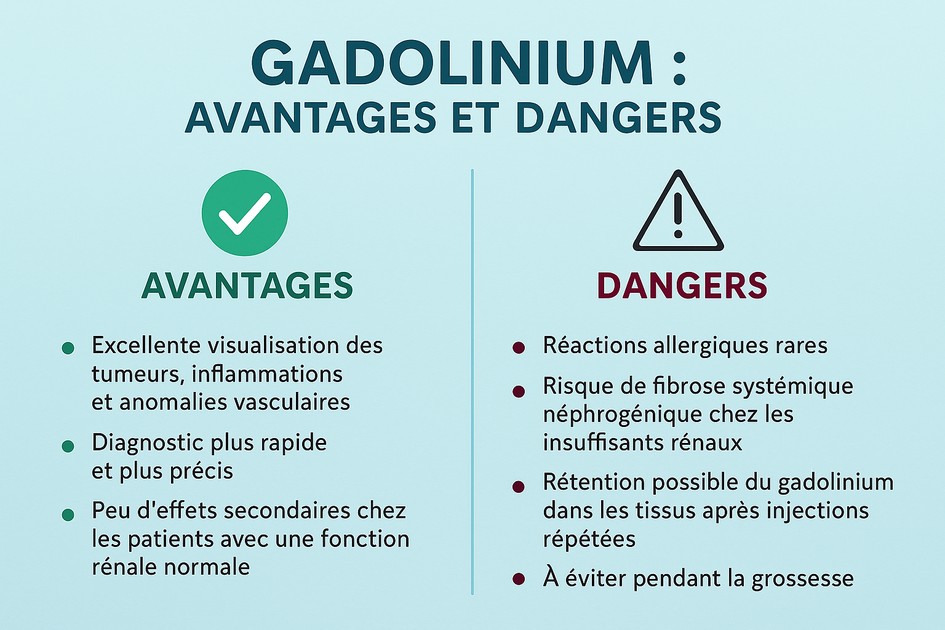La question de la violence sexuelle en EHPAD soulève des enjeux complexes, à la fois médicaux, éthiques et profondément humains. Trop souvent tabou, ce sujet mérite pourtant une vigilance accrue, car il touche à la dignité et à la sécurité de personnes particulièrement vulnérables. Parmi les facteurs de risque, certains sont encore insuffisamment explorés. C’est notamment le cas de l’influence des traitements médicamenteux sur le comportement sexuel des résidents.
En effet, certains médicaments – qu’il s’agisse de psychotropes, de dopaminergiques ou d'autres classes pharmacologiques – peuvent modifier l’impulsivité, désinhiber les comportements ou altérer le jugement, créant parfois un terrain propice à des passages à l’acte inappropriés. Ces effets, bien que connus dans la littérature, restent souvent sous-estimés dans la pratique clinique. Pourtant, dans certaines situations, ils peuvent jouer un rôle déclencheur ou aggravant, contribuant à des comportements inappropriés ou de violences, qu'elles soient actives ou passives, conscientes ou non.
Face à ces risques, une approche multidisciplinaire s’impose, alliant évaluation médicale rigoureuse, réflexion éthique et accompagnement institutionnel. Il est essentiel d’ouvrir un espace de parole au sein des équipes, d’intégrer ces dimensions dans les formations, et d’analyser chaque situation avec discernement pour prévenir autant que possible ces dérives, tout en respectant la complexité des parcours de vie des patients.
Des comportements sexuels inappropriés : une réalité en institution
En EHPAD, des situations de comportements sexuels désinhibés – avances sexuelles inadaptées, exhibitionnisme, attouchements, voire agressions – sont documentées. Chez la personne âgée souffrante de troubles cognitifs (démence, syndrome confusionnel), ces comportements peuvent résulter de la pathologie elle-même, mais aussi, crucialement, d’effets indésirables de certains traitements médicaux.
Médicaments en cause : qui sont-ils ?
Un nombre croissant de publications médicales, de retours de pharmacovigilance, de recommandations et des « mise en garde » dans les RCP (résumé des caractéristiques du produit) décrivent des classes thérapeutiques impliquées dans l’hypersexualité ou les troubles du contrôle des impulsions chez la personne âgée :
- Antiparkinsoniens à effet dopaminergique :
Les médicaments les plus pourvoyeurs : Lévodopa , Carbidopa ; les dérivés des alcaloïdes de l’ergot de seigle (Bromocriptine, Lisuride) , Apomorphine, Pramipexole .
Effets : Ils sont reconnus pour favoriser des troubles du contrôle des impulsions, dont l’hypersexualité, parfois associée à des comportements agressifs, ou compulsifs. Selon les RCP, ces troubles ont été rapportés spécialement à doses élevées et étaient généralement réversibles lors de la diminution de la dose ou l'arrêt du traitement. Dans quelques cas, d'autres facteurs étaient présents tels que des antécédents de comportements compulsifs.
- Antipsychotiques
Les médicaments les plus pourvoyeurs : Aripiprazole , rispéridone (agoniste dopaminergique partiel et sérotoninergique)
Effets : Ils ont été associés à des épisodes d’hypersexualité ou de désinhibition sexuelle.
- Antidépresseurs sérotoninergiques
Les médicaments les plus pourvoyeurs : ISRS comme sertraline, paroxetine, citalopram
Effets : Ils peuvent, chez certains patients, provoquer ou accroître des troubles du comportement sexuel, liés à la modification de la régulation des neurotransmetteurs centraux.
Un diagnostic souvent négligé
Les professionnels de santé ont parfois tendance à associer l’hypersexualité à l’aggravation d’une démence ou à un trouble psychiatrique. Pourtant, plusieurs études montrent que ces manifestations sont souvent sous-déclarées en tant qu’effets indésirables de certains médicaments, notamment chez les personnes âgées, d’autant plus que l’association de plusieurs médicaments exposant à ce type de troubles majore le risque.
Prise en charge : vigilance, signalement et adaptation thérapeutique
Face à tout changement brutal ou progressif du comportement sexuel d’un résident, il est primordial de réévaluer l’iatrogénie médicamenteuse :
- Revue systématique de la prescription.
- Signalement à l’équipe soignante et à la pharmacovigilance.
- Dialogue avec la famille et mesures immédiates pour garantir la sécurité physique et psychique de la victime présumée, conformément à la règlementation.
- Adaptation du traitement - une réduction de dosage ou un arrêt progressif devrait être envisagé(e) - si un lien est suspecté, en concertation avec le médecin traitant ou le gériatre référent.
Les comportements induits par les médicaments s’améliorent dans la plupart des cas après la réduction des doses ou l’arrêt des traitements impliqués.
Conclusion
En EHPAD, la violence sexuelle ne résulte pas uniquement de la maladie ou de comportements malveillants : elle peut également être favorisée par la prise de certains traitements médicamenteux. Suspecter la cause médicamenteuse face à des comportements sexuels nouveaux ou exacerbés est une démarche essentielle pour la sécurité des résidents et la qualité des soins. L'information des équipes, la vigilance partagée et une adaptation rapide de la prise en charge restent les clés de la prévention.
Références :
- https://www.cbip.be/fr/hypersexualite-avec-la-mianserine-et-dautres-antidepresseurs/
- https://www.aphp.fr/espace-medias/liste-ressources-presse/parkinson-des-troubles-du-controle-des-impulsions-frequents
- American Academy of Neurology: Neurology Resources | AAN
- https://www.cr3pa.fr/sites/default/files/Agression%20sexuelle%20en%20EHPAD.pdf
- https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/violences-sexuelles-les-outils-pour-lutter-contre-au-sein-des-etablissements-de-sante-et-medico
- https://www.has-sante.fr/jcms/p_3343670/fr/vie-affective-et-sexuelle-dans-le-cadre-de-l-accompagnement-en-essms-vas-note-de-cadrage
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10575650/
- https://www.has-sante.fr/jcms/c_1243427/fr/guide-parcours-de-soins-maladie-de-parkinson
- https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/medicament/60793381/extrait#tab-rcp
- https://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/rcp/R0274801.htm
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9825131/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40208331/