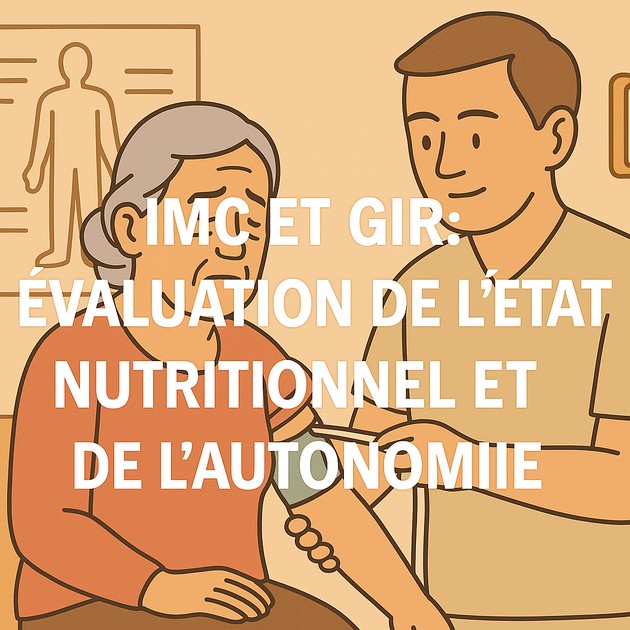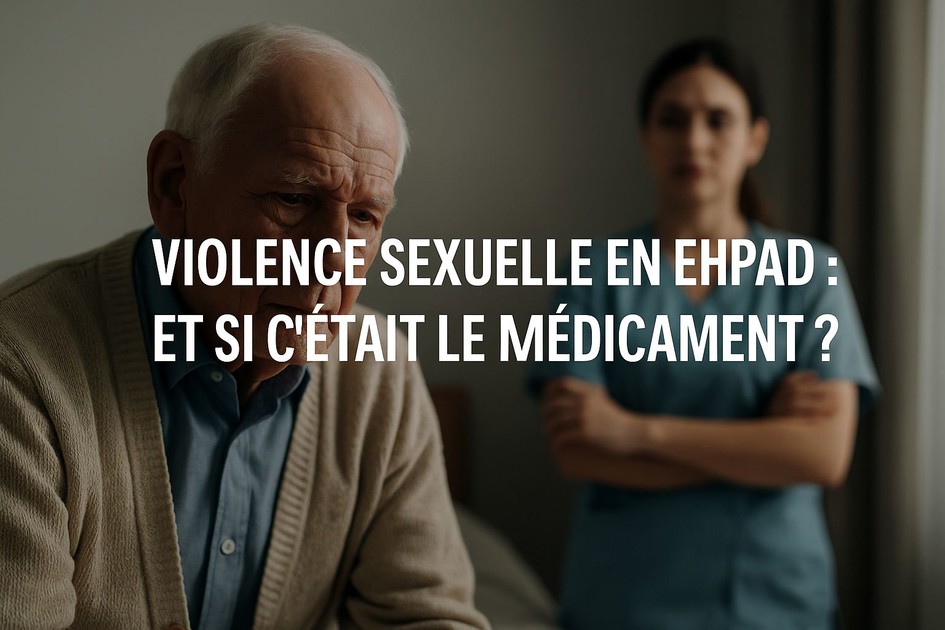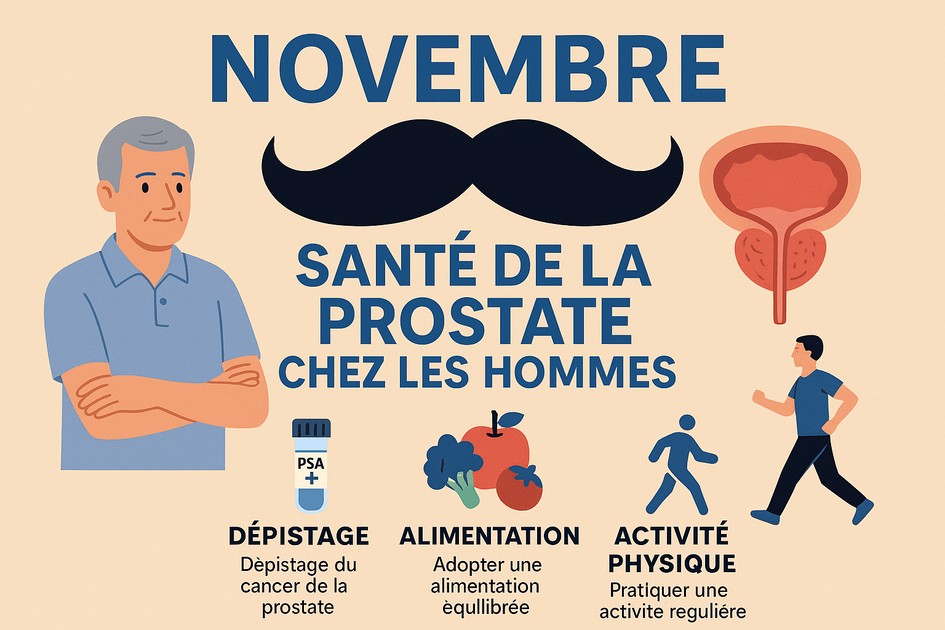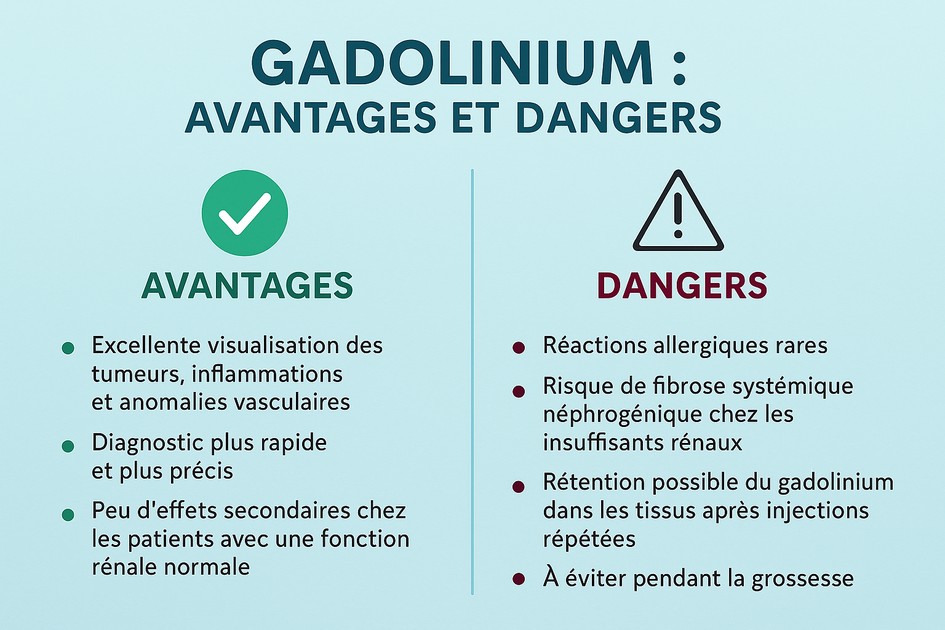Introduction
L’évaluation globale de la personne âgée ou dépendante repose sur deux piliers complémentaires : l’état nutritionnel, souvent mesuré par l’Indice de Masse Corporelle (IMC), et le niveau d’autonomie, évalué par la grille AGGIR (Groupe Iso-Ressources). Ces outils sont essentiels pour adapter la prise en charge, prévenir les complications et améliorer la qualité de vie. Comprendre leur utilité, leurs limites et leur articulation permet d’optimiser le suivi des patients, notamment en institution ou à domicile.
IMC : un indicateur clé du statut nutritionnel
L’IMC, calculé par la formule, est un repère simple et rapide pour estimer la corpulence et détecter la dénutrition ou l’obésité. Un IMC inférieur à 18,5 chez l’adulte, ou à 21 chez la personne âgée, signale une dénutrition, tandis qu’un IMC supérieur à 30 indique une obésité. Ces deux extrêmes exposent à des risques majeurs :
- Dénutrition : perte de masse musculaire, risque accru d’infections, de chutes, de fractures et de mortalité.
- Obésité : maladies cardiovasculaires, diabète, troubles articulaires, perte d’autonomie.
L’évolution rapide de l’IMC (perte de poids de 5 % en un mois ou 10 % en six mois) est un signal d’alerte, même si l’IMC reste dans la norme.
Évaluation de l’IMC
- Mesure du poids et de la taille : essentielle à chaque consultation. En cas d’impossibilité (grabatisation, déformation), la taille peut être estimée par la hauteur du genou avec des formules adaptées.
- Interprétation : l’IMC doit être analysé selon l’âge : chez les plus de 75 ans, un IMC inférieur à 21 est déjà préoccupant.
- Compléments : l’IMC n’est qu’un élément du diagnostic nutritionnel, qui doit inclure l’examen clinique, la recherche d’œdèmes, l’évaluation des apports alimentaires et la prise en compte du contexte médical et social.
Suivi nutritionnel
- Surveillance régulière de l’IMC : à chaque consultation ou au moins tous les trois mois en institution.
- Dépistage précoce des variations de poids : toute perte de poids rapide doit alerter et conduire à une évaluation approfondie.
- Prise en charge adaptée : enrichissement alimentaire, supplémentation, rééducation nutritionnelle, ou mesures de lutte contre l’obésité selon le cas.
Prévention des complications
- Éviter la dénutrition : dépistage systématique, éducation nutritionnelle, prise en charge des troubles de la déglutition ou des pathologies associées.
- Limiter l’obésité : conseils diététiques, encouragement à l’activité physique adaptée, suivi des comorbidités.
GIR : mesurer l’autonomie
La grille AGGIR classe les patients en six groupes selon leur capacité à réaliser seuls les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, déplacements). Le GIR 1 correspond à une dépendance totale, le GIR 6 à une autonomie complète. Un mauvais état nutritionnel aggrave la dépendance : la dénutrition diminue la force musculaire et la mobilité, accélérant la perte d’autonomie.
Évaluation de l’autonomie
- Grille AGGIR : utilisée lors de l’admission en institution ou pour l’attribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), elle permet de quantifier la perte d’autonomie et d’adapter les aides nécessaires.
- Lien IMC-GIR : une dénutrition ou une obésité sévère peut entraîner une dégradation du GIR, en limitant la mobilité et l’indépendance.`
Conclusion
L’IMC et le GIR constituent deux outils complémentaires et essentiels pour apprécier l’état nutritionnel et le niveau d’autonomie, notamment chez les personnes âgées ou dépendantes. Leur utilisation conjointe favorise un dépistage précoce des situations à risque, une adaptation personnalisée des prises en charge, ainsi qu’une prévention optimale des complications. Le suivi de l’autonomie repose sur une réévaluation périodique du GIR, permettant d’ajuster les aides humaines et techniques, et sur la prévention de la dépendance grâce au maintien de l’activité physique, à l’adaptation de l’environnement, ainsi qu’à la stimulation cognitive et sociale. Enfin, un suivi régulier, une approche multidisciplinaire et une attention constante portée à la fois à la nutrition et à l’autonomie demeurent indispensables pour préserver la qualité de vie et l’indépendance des patients.
Références :
- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/texte_pnds_oberar19072021.pdf
- https://www.has-sante.fr/jcms/c_591276/fr/denutrition-personne-agee-2007-argumentaire
- https://documentation.ehesp.fr/doc_num.php?explnum_id=201
- https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2024-07/DD118EMB.pdf
- https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2019SA0001Ra.pdf