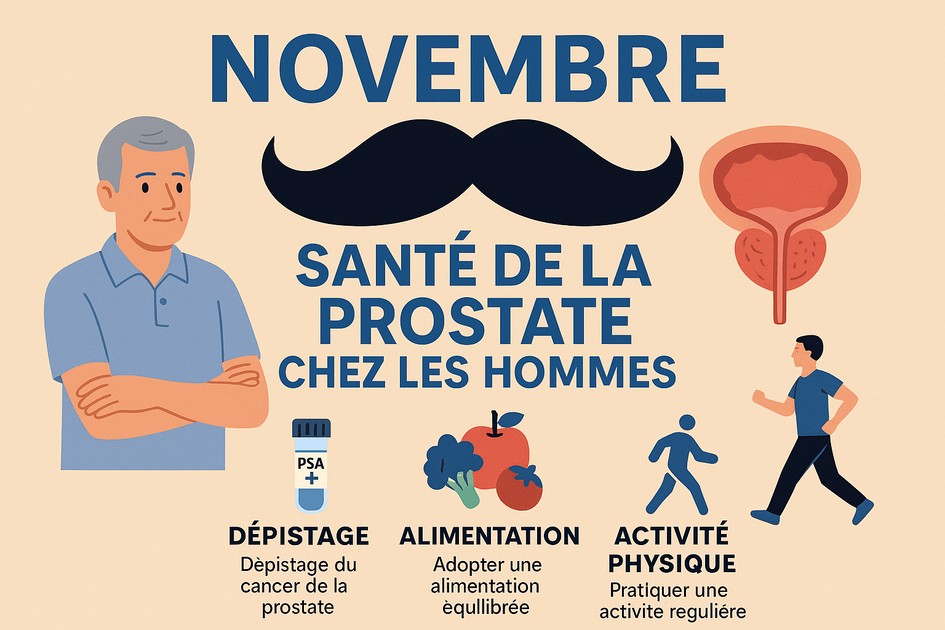Qu'est-ce que l'endométriose : mieux la comprendre et la diagnostiquer
L’endométriose est une maladie gynécologique chronique qui se caractérise par la présence de tissu semblable à l’endomètre, normalement localisé au sein de la muqueuse utérine, en dehors de la cavité utérine. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette pathologie affecte environ 10 % des femmes en âge de procréer dans le monde, soit environ 190 millions de personnes.
Qu’est-ce que l’endométriose ?
L’endométriose est une pathologie gynécologique chronique définie par la présence anormale de tissu endométrial, histologiquement semblable à celui qui tapisse normalement la cavité utérine, mais localisé en dehors de celle-ci.
Les localisations les plus fréquentes de l’endométriose concernent le péritoine pelvien, les ovaires, les ligaments utérosacrés, la vessie, le rectum, voire la paroi abdominale après des chirurgies gynécologiques. Dans certains cas plus rares, le tissu endométrial ectopique peut atteindre d'autres organes comme les poumons, le diaphragme ou les nerfs périphériques.
Trois formes anatomopathologiques principales sont reconnues :
● L’endométriose superficielle péritonéale.
● L’endométriose ovarienne (endométriomes).
● L’endométriose pelvienne profonde.
Il s’agit d’une maladie multifactorielle, à prévalence élevée, qui reste pourtant sous-diagnostiquée en raison de son expression clinique hétérogène, oscillant entre formes asymptomatiques et douleurs pelviennes invalidantes.
Les causes de l’endométriose
L’étiopathogénie de l’endométriose demeure à ce jour partiellement élucidée. Il existe toutefois plusieurs hypothèses physiopathologiques qui pourraient expliquer la genèse de cette pathologie.
Reflux menstruel ou menstruation rétrograde
La première théorie est celle du reflux menstruel. Ce phénomène, observé chez 90 % des femmes réglées, n’évoluerait en endométriose que chez celles présentant un défaut d’élimination ou de réponse immunitaire.
Métaplasie cœlomique
La théorie de la métaplasie cœlomique postule une transformation de cellules mésothéliales péritonéales en cellules de type endométrial sous l’influence de stimuli hormonaux ou inflammatoires. Celle-ci expliquerait notamment les localisations extra-pelviennes dans certains cas rares.
Origine embryonnaire ou génétique
Certains travaux suggèrent un dérèglement du développement embryonnaire des voies génitales ou une migration cellulaire des cellules endométriales lors de l’organogenèse. La probabilité de développer une endométriose est aussi multipliée par 6 si un membre de la famille du premier degré est atteint.
Autres facteurs favorisants
L’environnement hormonal œstrogéno-dépendant, certaines perturbations du système immunitaire et l’exposition à des perturbateurs endocriniens (phtalates, dioxines) pourraient également jouer un rôle dans l’initiation et la progression de l’endométriose.
Les symptômes de l’endométriose
L’endométriose se manifeste par une grande hétérogénéité clinique, rendant sa détection parfois complexe. Le délai moyen entre l’apparition des symptômes et le diagnostic dépasse souvent 7 ans.
Douleurs pelviennes chroniques
Le symptôme cardinal est la douleur pelvienne cyclique ou chronique, souvent corrélée au cycle menstruel, mais parfois continue. Elle peut prendre plusieurs formes :
● Dysménorrhée sévère.
● Dyspareunie profonde.
● Douleurs pelviennes non liées aux règles.
Ménométrorragies et autres troubles menstruels
L’endométriose peut être associée à des règles abondantes (ménorragies) confirmées par le Score de Higham, prolongées (polyménorrhée) ou irrégulières. L’inflammation chronique du tissu endométrial ectopique peut perturber l’homéostasie endométriale intra-utérine.
Troubles digestifs et urinaires
Les formes profondes atteignant le rectum, la vessie ou les uretères peuvent engendrer :
● Dyschésie (difficultés à l’évacuation des selles).
● Douleurs à la miction ou pollakiurie.
● Ballonnements et constipation ou diarrhée.
Infertilité
L’endométriose perturbe la fertilité par adhérences pelviennes, altération de la réserve ovarienne, inflammation péritonéale chronique ou modification de la réceptivité endométriale. On estime que cela toucherait entre 30 à 50 % des patientes.
Fatigue et troubles psychiques
L’inflammation chronique, la douleur persistante et l’errance diagnostique peuvent contribuer à un état d’épuisement physique et émotionnel, avec un risque accru de dépression et d’anxiété. L’endométriose doit ainsi être envisagée dans une prise en charge globale.
Comment diagnostiquer l’endométriose ?
Le diagnostic de l’endométriose repose sur un bilan pluridisciplinaire alliant clinique, imagerie et, parfois, confirmation histologique.
Examen clinique et interrogatoire
● Anamnèse ciblée (recueil des symptômes cycliques et leurs répercussions sur la qualité de vie).
● Examen gynécologique.
Ces étapes cliniques présentent toutefois une sensibilité limitée, surtout en cas d’endométriose ovarienne ou pelvienne profonde.
Imagerie pelvienne
● Échographie transvaginale.
● IRM pelvienne.
L’IRM offre une visualisation précise des lésions infiltrantes du péritoine, du rectum, de la vessie et du diaphragme, avec une sensibilité atteignant 95 %.
Confirmation par laparoscopie
La laparoscopie diagnostique demeure le gold standard, permettant :
● La visualisation directe des lésions.
● La résection chirurgicale ou la biopsie des foyers suspectés.
Les traitements de l’endométriose
La prise en charge de l’endométriose repose sur une approche multimodale, combinant des stratégies médicamenteuses, chirurgicales et de soutien.
Traitements médicamenteux
AINS et antalgiques
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) constituent la première ligne pour soulager la douleur pelvienne et réduire la production des prostaglandines.
Traitement hormonal
- Contraception hormonale continue (pilule en continu, patch, anneau) : supprime l’ovulation et la chute d’œstrogènes, freinant la croissance du tissu endométrial ectopique.
- Progestatifs (pilule, dispositifs intra-utérins libérant du Lévonorgestrel) : induisent un état pseudo-grossesse, entraînant une atrophie de l’endomètre et une réduction des symptômes.
- Analogues de la GnRH (agonistes ou antagonistes) : provoquent une ménopause artificielle, utilisés sur une durée limitée (6 à 12 mois) pour éviter la perte osseuse.
Traitements chirurgicaux
Laparoscopie conservatrice
● Intervention recommandée pour les formes symptomatiques, permettant l’excision des lésions, le drainage des endométriomes et la libération des adhérences.
● Permet une amélioration significative de la douleur, de la fertilité et de la fonction sexuelle, tout en limitant les récidives.
Hystérectomie
Envisagée dans les cas sévères, en suppression de l’utérus et parfois des ovaires, lorsque la fertilité n’est plus envisagée et après échec des autres options.
Approches complémentaires
● Physiothérapie périnéale et du plancher pelvien.
● Support psychologique et thérapies cognitivo-comportementales.
● Acupuncture et supplémentation en vitamines.
Les risques associés à l’endométriose
L’endométriose, au-delà de ses symptômes chroniques, est associée à plusieurs complications impactant la fertilité, la qualité de vie et le pronostic à long terme.
Infertilité
L’infertilité est l’un des enjeux majeurs de l’endométriose. Les mécanismes impliqués comprennent :
● Altération anatomique des trompes ou des ovaires par les lésions ou les adhérences.
● Inflammation pelvienne chronique affectant la qualité ovocytaire, la fécondation ou la nidation.
● Présence d’endometriomes ovariens réduisant la réserve ovarienne.
Douleur chronique
L’endométriose est une pathologie douloureuse, souvent inflammatoire et récidivante, qui peut engendrer une douleur pelvienne invalidante, des dyspareunies, des dysuries ou des troubles digestifs selon la localisation des lésions (vessie, rectum, cul-de-sac de Douglas).
Risque d’évolution ou de complications
Bien que bénigne, l’endométriose peut présenter un comportement invasif, en particulier sous forme profonde infiltrante. Dans de rares cas (< 1 %), une transformation maligne de l’endométriose ovarienne (en carcinome à cellules claires ou en carcinome endométrioïde) a été décrite.
Vivre avec l’endométriose : témoignages et soutien
L’endométriose est une pathologie gynécologique chronique dont la prise en charge dépasse la seule sphère médicale.
Témoignages de patientes
De nombreuses femmes rapportent une errance diagnostique prolongée, avec des délais de plusieurs années entre l’apparition des premiers symptômes et le diagnostic. Cette temporalité entraîne souvent une souffrance psychologique importante, marquée par :
● L’incompréhension des proches et du corps médical.
● La banalisation des douleurs menstruelles intenses.
● L’isolement et le sentiment d’invisibilité.
Les témoignages soulignent aussi la variabilité des parcours thérapeutiques et l’impact sur la vie personnelle, conjugale et professionnelle.
L’importance du soutien médical et psychologique
La prise en charge repose sur :
● Un suivi régulier avec un gynécologue spécialisé.
● Un accompagnement psychothérapeutique.
● Le recours à des groupes de parole ou associations de patientes.
Les approches complémentaires comme la sophrologie, l’ostéopathie, ou encore l’accompagnement nutritionnel peuvent également participer à l’amélioration du bien-être global.
Endométriose et grossesse : ce que vous devez savoir
L’endométriose est l’une des premières causes d’infertilité féminine. Néanmoins, cela n'est pas systématique et de nombreuses patientes réussissent à concevoir.
Traitements et stratégie de conception
La prise en charge de l’endométriose dans un contexte de désir de grossesse repose sur une concertation multidisciplinaire. Plusieurs options sont possibles :
● Traitement médical suspendu (la contraception hormonale utilisée est arrêtée).
● Coelioscopie chirurgicale.
● AMP (Assistance Médicale à la Procréation).
Endométriose pendant la grossesse
La grossesse exerce souvent un effet transitoirement bénéfique sur les symptômes. Les menstruations étant interrompues, la stimulation hormonale des lésions est réduite. Toutefois, certaines complications obstétricales peuvent survenir :
● Risques accrus de grossesse extra-utérine.
● Augmentation des risques de prématurité ou de décollement placentaire.
● Surveillance renforcée en cas de formes sévères ou profondes d’endométriose.
Prévenir l’endométriose : Est-ce possible ?
À ce jour, il n’existe pas de méthode de prévention validée pour l’endométriose. Toutefois, certaines pistes émergent de la recherche biomédicale et peuvent contribuer à réduire les facteurs de risque.
Facteurs de risque identifiés
Les études ont mis en évidence plusieurs facteurs associés à un risque accru de développer une endométriose :
● Antécédents familiaux de la maladie (risque multiplié par 5 à 7).
● Règles précoces (ménarche avant 11 ans) et cycles courts ou abondants.
● Exposition prolongée aux œstrogènes endogènes ou exogènes.
La prévention primaire reste difficile du fait du caractère souvent asymptomatique ou insidieux des formes débutantes.
Approches de réduction des risques
Bien que non curatives, certaines stratégies sont envisagées pour réduire l’inflammation pelvienne chronique et l’environnement œstrogéno-dépendant :
● Activité physique régulière.
● Régime alimentaire anti-inflammatoire (riche en oméga-3, fibres, fruits et légumes).
● Éviction du tabac et de l’alcool.
Questions fréquentes sur l’endométriose
Peut-on guérir de l’endométriose ?
Il n’existe pas de traitement curatif définitif à ce jour. Les traitements visent à soulager les symptômes, à limiter l’évolution des lésions et à améliorer la qualité de vie.
L’endométriose cause-t-elle toujours l’infertilité ?
Non. Si l’endométriose est un facteur reconnu d’infertilité, toutes les femmes atteintes ne sont pas infertiles.
Est-ce une maladie génétique ?
Il existe une prédisposition familiale, mais l’endométriose n’est pas une maladie purement génétique. Les facteurs environnementaux et hormonaux interagissent dans son développement.