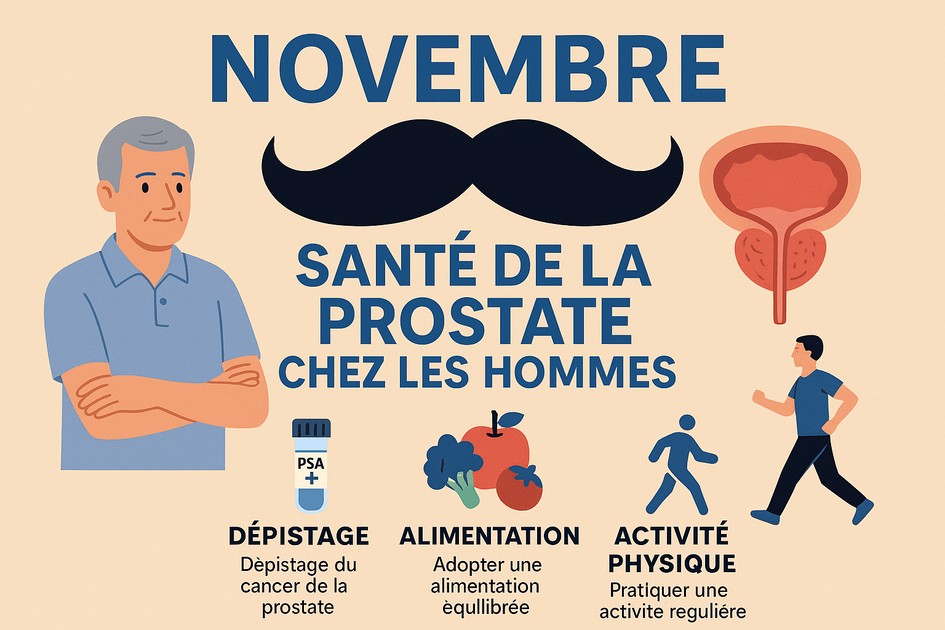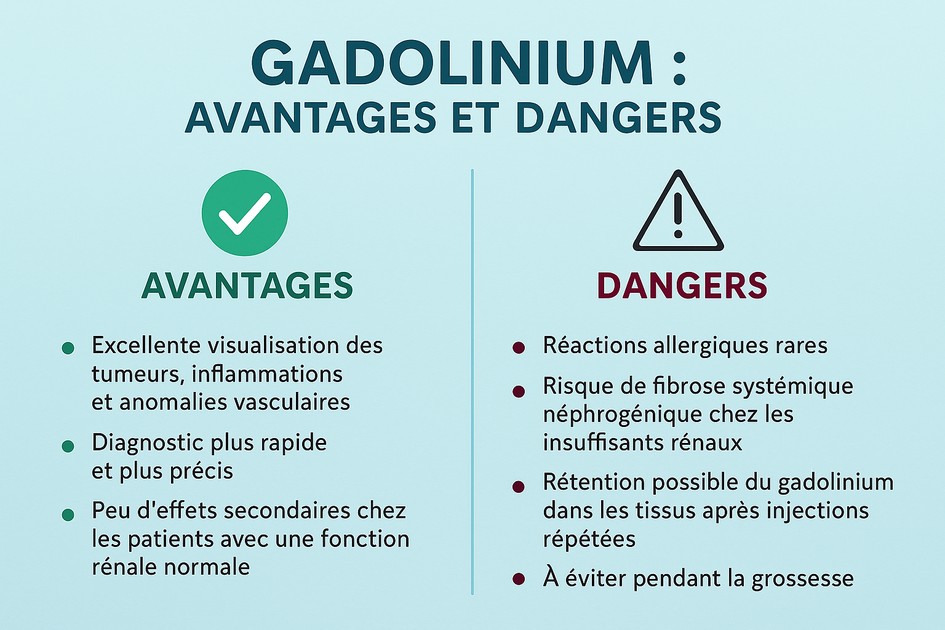Réduire les risques de cancer de la peau : adopter les bons gestes
Les cancers de la peau représentent les tumeurs malignes les plus fréquentes en dermatologie, particulièrement dans les régions à forte exposition solaire. Ils résultent d’une prolifération anarchique de cellules épidermiques, majoritairement induite par les rayons ultraviolets (UV).
Qu’est-ce que le cancer de la peau ?
Le terme « cancer de la peau » regroupe plusieurs entités distinctes par leur histogenèse, leur pronostic et leur prise en charge :
● Carcinome basocellulaire : le plus fréquent. Il se développe à partir des cellules basales de l’épiderme. Sa croissance est lente, avec un faible potentiel métastatique, mais un risque élevé de récidive locale.
● Carcinome épidermoïde (spinocellulaire) : issu des kératinocytes. Plus agressif, il peut évoluer vers une dissémination ganglionnaire ou métastatique, surtout en l’absence de traitement précoce.
● Mélanome cutané : tumeur maligne des mélanocytes, cellules pigmentaires. Peu fréquent, mais à fort potentiel invasif. Son pronostic dépend de son épaisseur (indice de Breslow) au moment du diagnostic.
Les causes du cancer de la peau
Exposition aux UV solaires et artificiels
La principale cause est l’exposition chronique ou intermittente aux rayonnements UVB et UVA, entraînant des mutations somatiques de l’ADN épidermique.
Phototypes à risque
Les individus à phototype I ou II, avec faible capacité de pigmentation et forte réactivité aux UV, présentent un risque accru de carcinogenèse cutanée.
Facteurs génétiques
Les mutations germinales de CDKN2A ou BRAF sont associées à un risque familial accru de mélanome. Une histoire familiale justifie une surveillance dermatologique renforcée.
Lésions cutanées précancéreuses
Des altérations chroniques de l’épiderme peuvent précéder ou accompagner le développement tumoral :
● Kératose actinique.
● Mélanose de Dubreuilh.
● Cicatrices, ulcérations chroniques et dermatoses inflammatoires.
Les meilleures stratégies pour éviter le cancer de la peau
Photoprotection topique
La première mesure est l’application d’un écran solaire à large spectre (SPF ≥ 30) 20 à 30 minutes avant l’exposition, puis toutes les deux heures ou après chaque baignade.
Protection vestimentaire
Les vêtements certifiés anti-UV, les chapeaux à large bord et les lunettes conformes à la norme CE complètent la photoprotection topique, notamment en cas d’exposition prolongée.
Éviter les expositions aux heures à risque
Entre 10h et 16h, l’intensité du rayonnement UV est maximale. Il convient de limiter les activités en plein air sur cette plage horaire ou de privilégier les zones ombragées, sous abri ou parasol.
Précautions en milieu aquatique
L’effet de réverbération de l’eau et du sable majore le risque. Une protection résistante à l’eau et le port d’un t-shirt anti-UV sont fortement recommandés.
Le rôle de l’autosurveillance dans la prévention du cancer de la peau
Inspection cutanée systématique
Un auto-examen mensuel, après la douche, en lumière naturelle, permet d’inspecter l’ensemble du tégument. Les zones difficiles (cuir chevelu, dos, plis) nécessitent l’aide d’un miroir ou d’un proche.
Règle ABCDE
Toute lésion pigmentée ou non pigmentée présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes doit alerter :
● A : Asymétrie.
● B : Bords irréguliers ou mal définis.
● C : Couleur non homogène.
● D : Diamètre > 6 mm.
● E : Évolution rapide (taille, forme, saignement, prurit).
Quand consulter ?
Une modification récente, un grain de beauté suspect, ou l’apparition d’une nouvelle tache justifie une consultation dermatologique rapide.
Les examens dermatologiques réguliers : pourquoi sont-ils importants ?
Bilans cutanés spécialisés
L’examen clinique complet (Total Body Skin Exam) est systématique. Il peut être complété par la dermatoscopie, et, chez certains patients à risque, par la photographie corps entier ou la surveillance numérique des nævus.
Fréquence des consultations
La fréquence du dépistage dépend de plusieurs facteurs :
● Population générale : tous les 1 à 2 ans à partir de 40 ans.
● Sujets à risque élevé : tous les 6 à 12 mois.
● Patients immunodéprimés : suivi dermatologique rapproché selon avis spécialisé.
L’objectif est de détecter les lésions à un stade in situ ou invasif précoce.
Les habitudes de vie qui contribuent à prévenir le cancer de la peau
Renoncer au bronzage artificiel
Le bronzage en cabine UV est classé cancérogène certain (groupe 1) par le CIRC. Il augmente le risque de mélanome et de carcinome épidermoïde, en particulier chez les sujets exposés jeunes.
Attention aux photosensibilisants
Certains médicaments augmentent la sensibilité cutanée aux UV (antibiotiques, anti-inflammatoires, traitements oncologiques, etc.). En période d’exposition, il convient de :
● Vérifier la phototoxicité potentielle des traitements en cours.
● Renforcer la photoprotection.
● Adapter les horaires d’activité extérieure.
Rôle de l’alimentation et des antioxydants
Une alimentation riche en antioxydants naturels contribue à la défense de l’épiderme contre les dommages induits par les UV. Les micronutriments les plus impliqués sont :
● Vitamines C et E : fruits rouges, agrumes, huiles végétales.
● Polyphénols : thé vert, cacao, fruits à coque.
● Oméga-3 : poissons gras (sardine, maquereau, saumon), graines de lin.
Les traitements précoces contre le cancer de la peau
Lésions précancéreuses
Le traitement des lésions précancéreuses ou des formes débutantes repose sur :
● Kératose actinique : prise en charge par cryothérapie, photothérapie dynamique ou traitement topique (imiquimod, diclofénac, 5-FU).
● Mélanome in situ et carcinomes superficiels : exérèse chirurgicale avec marges de sécurité conformes aux recommandations en vigueur.
Autres options thérapeutiques
Selon les cas, des approches alternatives sont possibles :
● Chirurgie micrographique de Mohs (zones à haut risque fonctionnel).
● Immunothérapie topique (imiquimod).
● Chimiothérapie locale (5-fluorouracile).
● Laser CO₂ (lésions superficielles multiples).
Comment réagir si vous détectez une lésion suspecte ?
Toute lésion cutanée évolutive ou atypique requiert une évaluation rapide. Il est recommandé de :
● Photographier la lésion pour en documenter l’évolution.
● Noter la date d’apparition et les modifications observées.
● Consulter sans délai si l’un des critères ABCDE est présent ou en cas de contexte à haut risque.