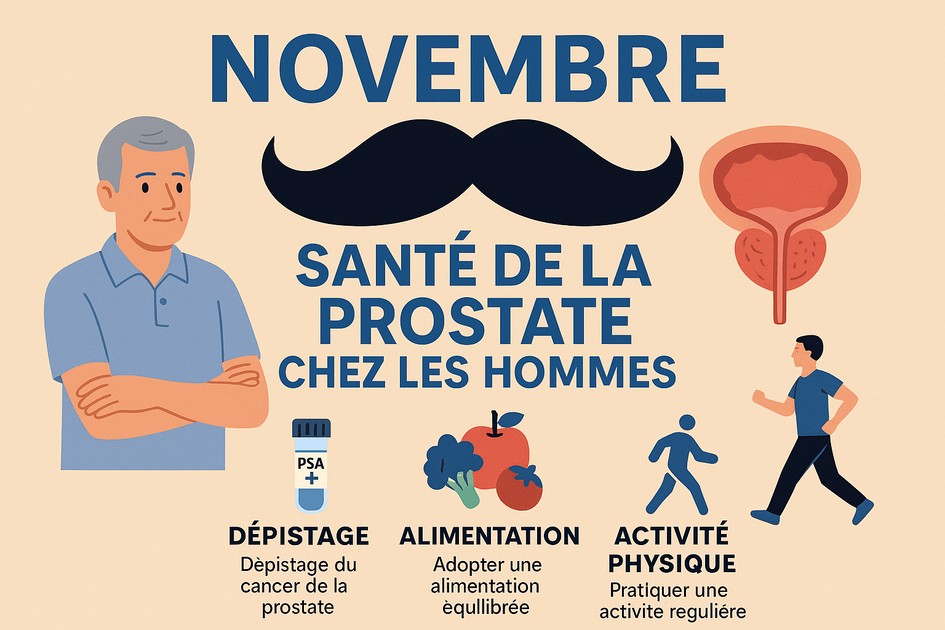Comment bien choisir sa contraception ?
Il n'est pas toujours évident de choisir sa contraception. Il s'agit d'une démarche médicale qui implique une évaluation rigoureuse des besoins, des préférences et du profil de santé de chaque femme.
En France, plus d’une dizaine de méthodes contraceptives sont accessibles, chacune présentant des caractéristiques spécifiques en termes d'efficacité, de mode d’administration, de tolérance et de réversibilité.
Pourquoi est-il important de bien choisir sa contraception ?
Adopter une contraception adaptée permet de concilier efficacité contraceptive, respect de l’autonomie reproductive et qualité de vie. Au-delà de la prévention des grossesses non désirées, il s’agit d’un levier de santé publique qui favorise un rapport apaisé à sa fertilité et à sa vie sexuelle.
Le choix d’une méthode ne peut être dissocié d’une analyse fine du mode de vie, de l’environnement relationnel et des antécédents médicaux. Certaines pathologies chroniques, contre-indications hormonales ou habitudes comme le tabagisme, nécessitent une vigilance particulière.
De même, les troubles menstruels, qu’ils soient douloureux, abondants ou irréguliers, doivent être intégrés dans l’approche thérapeutique, avec des outils comme le score de Higham pour objectiver les pertes sanguines.
Le docteur prend également en compte la dimension psychologique avant de rendre sa décision. Une contraception mal vécue affecte la sexualité, majore la charge mentale et induit un sentiment d’insécurité.
Les différentes méthodes de contraception disponibles
Il existe cinq grandes familles de contraceptions.
1. Contraception hormonale
Ces méthodes agissent principalement par inhibition de l’ovulation et modification de la glaire cervicale :
● Pilule œstroprogestative ou progestative seule (prise quotidienne par voie orale).
● Patch transdermique (application hebdomadaire).
● Anneau vaginal (insertion mensuelle, retrait toutes les 3 semaines).
● Implant sous-cutané (efficacité jusqu’à 3 ans).
● Injection trimestrielle (administration intramusculaire tous les 3 mois).
2. Contraception mécanique ou de barrière
Elle prévient physiquement la rencontre entre spermatozoïdes et ovocyte :
● Préservatif masculin et féminin (seule méthode à protéger aussi des IST).
● Diaphragme et cape cervicale (à associer à un spermicide).
3. Méthodes permanentes
Souvent choisies en fin de parcours contraceptif, elles reposent sur une interruption définitive de la fertilité :
● Stérilisation tubaire (ligature des trompes) chez la femme.
● Vasectomie chez l’homme, suivie d’une confirmation d’azoospermie.
4. Méthodes naturelles
La méthode du calendrier (Ogino) et la symptothermie (observation des courbes de température et de la glaire cervicale) sont réservées aux cycles très réguliers et leur efficacité dans le temps est faible.
5. Contraception d’urgence
Elle intervient après un rapport à risque, mais ne constitue pas un moyen contraceptif à part entière :
● Pilule du lendemain à base de lévonorgestrel ou d’ulipristal.
● DIU au cuivre (pose possible jusqu’à 5 jours après le rapport, avec une efficacité > 99 %).
Comment choisir la méthode de contraception qui vous convient ?
Les facteurs à considérer
● Âge et projet d’enfant.
● Antécédents médicaux (thrombose, diabète, HTA, cancer du sein).
● Vie sexuelle (partenaire stable ou non, nombre de rapports).
● Traitement actuel.
● Consommation de tabac chez les femmes de plus de 35 ans.
● Mode de vie et lieu de résidence.
● Existence d’une maladie ou d’un cycle menstruel irrégulier.
Les effets secondaires à connaître
Les contraceptifs hormonaux peuvent entraîner des céphalées, des mastodynies, des troubles de l’humeur, du spotting, de l'acné ou une prise de poids. Une bonne information en amont améliore l’adhésion.
La concertation avec un professionnel de santé permet d’intégrer toutes ces données dans une prise de décision partagée.
Contraception hormonale : avantages et inconvénients
La contraception hormonale repose sur l’administration d’hormones stéroïdiennes de synthèse (œstrogènes et/ou progestatifs) pour inhiber l’ovulation et modifier l’environnement utérin.
Avantages
● Très haute efficacité contraceptive (indice de Pearl < 1).
● Régulation du cycle, réduction des règles abondantes et de la dysménorrhée.
● Amélioration de certaines affections gynécologiques fonctionnelles.
● Réversibilité rapide après arrêt.
Inconvénients
● Risque thromboembolique, particulièrement en cas de facteurs associés.
● Contre-indications : thrombose, pathologies hépatiques et cancers hormono-dépendants.
● Interactions possibles avec certains traitements (antiépileptiques, rifampicine, etc.).
● Effets secondaires variables selon le profil hormonal.
Le bilan médical initial permet d’évaluer le rapport bénéfice/risque, d’adapter la méthode de contraception, de répondre aux questions de la patiente, et de déterminer la solution qui convient le mieux à sa situation.
Contraception de barrière : pourquoi l’utiliser ?
Les méthodes de contraception mécaniques, aussi appelées méthodes de barrière, empêchent la rencontre entre les spermatozoïdes et l’ovocyte, sans recours aux hormones.
Protection contre les IST
Le préservatif masculin externe est actuellement le seul moyen de contraception qui protège à la fois contre les grossesses et les infections sexuellement transmissibles (IST), telles que le VIH, les chlamydioses, l’herpès, les hépatites ou les papillomavirus. Il est recommandé lors d'un premier rapport ou en cas de partenaires multiples.
Le préservatif féminin interne est moins connu mais offre une protection équivalente. Il s’insère dans le vagin avant le rapport sexuel et protège l’ensemble de la muqueuse.
Types et efficacité
● Préservatif masculin : indice de Pearl = 2.
● Préservatif féminin : indice de Pearl = 5.
● Diaphragme ou cape cervicale : indice de Pearl = 6 à 12.
Avantages
● Accessibles sans prescription.
● Réversibles immédiatement.
● Sans effet systémique ni interaction médicamenteuse.
Inconvénients
● Dépendance à l’utilisateur (mauvaise pose, rupture, oubli d’utilisation...).
● Moindre efficacité contraceptive par rapport aux méthodes hormonales ou au stérilet.
Les méthodes naturelles de contraception : quand les utiliser ?
Les méthodes naturelles s’appuient sur l’observation des marqueurs physiologiques du cycle menstruel afin d’identifier la fenêtre de fertilité et d’éviter les rapports à risque durant cette période.
Principes et types
● Méthode du calendrier (Ogino-Knaus).
● Méthode symptothermique (surveillance de la température basale et de la glaire cervicale).
● Méthode Billings (observation exclusive des variations de la glaire).
● Méthode des jours fixes (Standard Days).
Avantages
● Pas d’effets secondaires systémiques.
● Respect des cycles naturels.
● Aucune contre-indication médicale.
Inconvénients
● Fiabilité moindre en usage typique (l’indice de Pearl peut dépasser 10).
● Nécessite une grande rigueur et une période d’apprentissage.
● Aucune protection contre les IST.
Elles sont particulièrement déconseillées aux adolescentes, aux jeunes femmes en période d’instabilité hormonale ou en cas de cycle irrégulier.
Les contraceptifs d’urgence : un recours temporaire
La contraception d’urgence est une mesure destinée à prévenir une grossesse non désirée après un rapport sexuel non protégé ou en cas d’échec contraceptif (préservatif rompu, oubli de pilule, etc.).
Options disponibles
● Lévonorgestrel : à administrer idéalement dans les 12 heures suivant le rapport, jusqu’à 72 heures. L’efficacité décroît avec le temps.
● Ulipristal acétate : actif jusqu’à 120 heures. Plus efficace en phase péripubertaire ou chez les patientes à IMC élevé.
● DIU au cuivre : méthode la plus fiable (> 99 %), à poser dans les 5 jours suivant le rapport, avec effet contraceptif prolongé.
Limites et précautions
● Pas efficace à 100 %, surtout si prise tardive ou en cas de vomissements.
● Effets indésirables possibles (nausées, troubles du cycle, céphalées...).
● Aucune protection contre les IST.
● Utilisation fréquente déconseillée.
Une consultation médicale permet d’évaluer l’option la plus adaptée et de mettre en place une contraception régulière dans la continuité.
Les conseils pratiques pour bien choisir sa contraception
Le choix d’un moyen de contraception doit être fondé sur une évaluation médicale et sur un dialogue entre la patiente et le professionnel de santé.
Consulter un professionnel de santé
Un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme sont en mesure de :
● Évaluer les contre-indications médicales.
● Prescrire les examens nécessaires.
● Proposer un dispositif compatible avec l’état de santé et le mode de vie.
● Assurer le suivi médical (notamment tension artérielle, poids et effets indésirables).
Dialoguer avec son partenaire
La discussion au sein du couple améliore l’adhésion, aide à la gestion des effets secondaires, favorise le respect mutuel et permet une approche partagée de la contraception, notamment pour les méthodes de barrière ou naturelles.
Tester plusieurs options si besoin
Une méthode mal tolérée ou inadaptée peut être réévaluée à tout moment. Le suivi régulier permet d’ajuster la stratégie contraceptive au fil de l’évolution personnelle ou médicale de la patiente.
Contraception et grossesse : que faire si vous changez d’avis ?
Le désir de concevoir un enfant peut survenir à tout moment du parcours contraceptif. Dans ce cas, il faut stopper la méthode contraceptive en cours et instaurer un suivi médical.
● Pour les méthodes hormonales, la fertilité revient en général rapidement, mais un délai de quelques semaines à quelques mois est parfois observé avant la reprise d’un cycle régulier.
● Le DIU (Dispositif Intra-Utérin) peut être retiré à tout moment, avec un retour à la fertilité immédiat.
● Après une injection contraceptive, un allongement du délai de conception est possible (jusqu’à 6 à 12 mois).
● Pour les méthodes naturelles, l’arrêt est automatique dès suspension du suivi des signes biologiques.
Une consultation préconceptionnelle permet d’adapter le traitement en cas de pathologie chronique, de mettre à jour la vaccination (rubéole, coqueluche, grippe), de prescrire une supplémentation en acide folique et de corriger les éventuels facteurs de risque (tabac, alcool, IMC élevé).
L’accompagnement par un professionnel de santé est indispensable pour sécuriser la transition entre contraception et projet parental, dans un cadre médicalisé, éthique et respectueux du choix de la patiente.