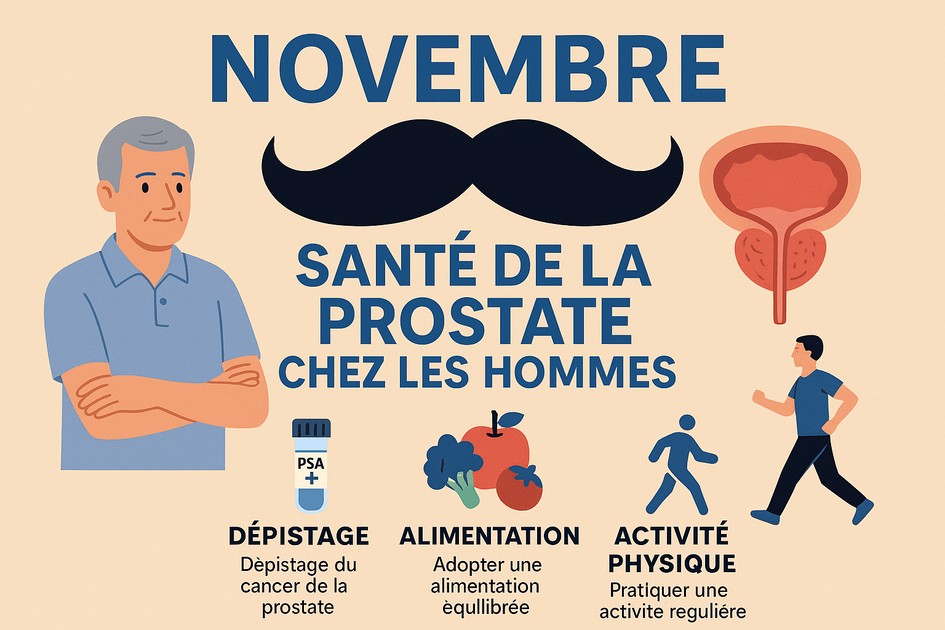Introduction
L’accès palustre, manifestation clinique du paludisme, représente une urgence infectieuse potentiellement mortelle, particulièrement chez les personnes non immunisées revenant de zones d’endémie. Le paludisme, maladie parasitaire transmise par la piqûre de moustiques Anophèles infectés par des parasites du genre Plasmodium, reste la parasitose la plus meurtrière dans le monde, avec des formes graves principalement dues à Plasmodium falciparum. La reconnaissance rapide des symptômes, la confirmation diagnostique et la mise en route d’un traitement adapté sont essentiels pour réduire la mortalité et prévenir les complications.
Mécanismes
Le paludisme est provoqué par la multiplication de parasites Plasmodium dans les globules rouges après leur transmission par la salive du moustique. Les espèces les plus fréquentes sont P. falciparum, P. vivax, P. ovale,P. malariae et, plus récemment, P. knowlesi. Après une phase hépatique silencieuse, les parasites envahissent la circulation sanguine, détruisant les globules rouges et libérant des toxines responsables des accès fébriles typiques. La gravité dépend du niveau de parasitémie et de la capacité de l’organisme à contrôler l’infection : chez les sujets non immunisés, l’évolution vers des formes graves est rapide.
Symptômes et complications
L’accès palustre se manifeste initialement par des fièvres élevées, souvent accompagnées de frissons intenses, de céphalées, de myalgies, de nausées et de vomissements. Les accès fébriles présentent une périodicité caractéristique selon l’espèce, mais cette périodicité est souvent absente lors des premiers épisodes.
Les signes de gravité, surtout rencontrés avec P. falciparum, incluent :
- Troubles neurologiques (neuropaludisme) : confusion, coma, convulsions.
- Défaillance multiviscérale : insuffisance rénale, détresse respiratoire, choc, hémorragies, anémie sévère.
- Acidose métabolique et hyperlactatémie.
- Hyperparasitémie (taux élevé de globules rouges parasités).
Sans traitement rapide, la mortalité peut atteindre 50% dans les formes graves.
Diagnostic
Le diagnostic d’accès palustre doit être évoqué devant toute fièvre inexpliquée chez une personne ayant séjourné, même anciennement, en zone d’endémie. Le diagnostic de certitude repose sur :
- Frottis sanguin et goutte épaisse : recherche et identification des formes parasitaires, quantification de la parasitémie.
- Tests de diagnostic rapide : utiles en première intention, mais toujours confirmés par l’examen microscopique.
Il est crucial de rechercher systématiquement les signes de gravité pour orienter la prise en charge en réanimation si besoin.
Suivi et prévention
Le traitement dépend de la sévérité de l’accès :
- Formes simples : traitement oral par associations à base d’artémisinine (artéméther-luméfantrine, arténimol-pipéraquine).
- Accès graves : hospitalisation en soins intensifs, traitement de référence par artésunate intraveineux(AS), qui a supplanté la quinine en raison de sa rapidité d’action et de sa meilleure tolérance. Dès amélioration, le relais est pris par voie orale.
- Antibiothérapie : envisagée en cas de suspicion de co-infection bactérienne grave.
Le retard diagnostique et thérapeutique est un facteur majeur de mauvais pronostic.
La prévention repose sur :
- Protection antivectorielle : moustiquaires imprégnées, répulsifs, vêtements couvrants.
- Chimioprophylaxie : prise d’antipaludiques adaptée au séjour en zone d’endémie.
- Information et vigilance : toute fièvre au retour d’une zone impaludée doit faire suspecter un accès palustre jusqu’à preuve du contraire.
Conclusion
L’accès palustre est une urgence médicale dont la gravité impose une prise en charge rapide et adaptée. La reconnaissance précoce des symptômes, la confirmation diagnostique par frottis sanguin et la mise en route immédiate du traitement, en particulier par artésunate pour les formes graves, sont essentielles pour réduire la mortalité. La prévention, fondée sur la protection contre les piqûres et la chimioprophylaxie, reste le meilleur moyen d’éviter cette maladie potentiellement fatale.
Références :
- https://www.larevuedupraticien.fr/article/acces-palustre-grave
- https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/02_congres/Urgences/urgences2014/donnees/pdf/028.pdf
- https://pharmacomedicale.org/medicaments/par-specialites/item/antipaludeens-les-points-essentiels
- https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/20140624-JForm-Infectiologie-F_BRUNEEL-NouveautesSurLeTraitementDesAccesPalustres.pdf
- https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php?q=acc%C3%A8s+palustre
- https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/pilly-etudiant/items-edition-2023/pilly-2023-item-170-copyright.pdf
- https://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques-et-retours-d-experience/Tous-les-cas-cliniques/Medecin/deces-au-decours-d-un-acces-palustre-a-plasmodium-falciparum